"Dans les sillons du premier chapitre" de Pascale Guillaumin
- Jean Benjamin Jouteur
- 5 sept. 2025
- 3 min de lecture
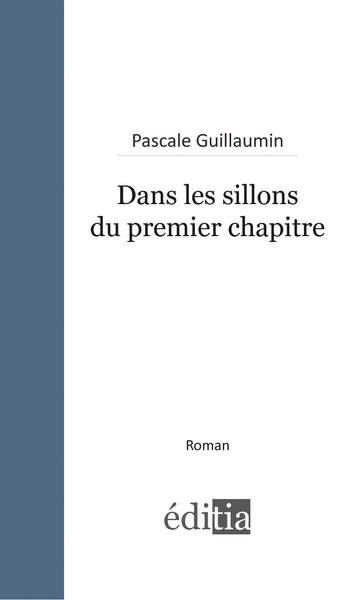
C’est un texte triste et beau, un peu comme la vie. Il est éclairé par la voix d’une adolescente qui, tenant son journal, nous confie l’amour qu’elle porte à Justine et Célestin, deux personnes âgées dont l’existence a été cabossée par un siècle parfois cruel.
Tic-Tac, Tic- Tac... on entend le temps passer dans le chuchotement de la pendule et des gestes qui se raréfient.
La narratrice adolescente observe ses vieux amis avec une attention tendre. Elle enregistre ce qui demeure quand tout s’efface : l’entraide, les petites habitudes, les éclats de mémoire qui affleurent, la pudeur devant la fatigue des corps. Son regard n’idéalise rien : il accueille le réel et son lot de rugosité et d’injustice. Il n’en rajoute pas, il raconte sans pathos, et c’est ça qui rend la mélancolie supportable et, paradoxalement, lumineuse.
Il y a dans ce texte une naïveté innocente et juste. La jeune narratrice n’a pas encore les phrases toutes faites des adultes, elle tâtonne, écrivant les choses comme elles viennent, au plus près de ses sensations.
La naïveté n’est pas une faiblesse : c’est l’outil le plus affûté pour dire ce qui se dérobe.
Au fil des pages, j’ai croisé Brel et ses Vieux. Tout y est : La fuite du temps, les gestes qui se réduisent, la maison qui devient le seul horizon. Mais là où le grand Jacques chantait depuis la scène, la narratrice murmure. On n’entend plus la grande litanie du temps, mais le cliquetis des secondes. La prose de Pascale offre une variation intime du magnifique poème de Brel.
Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, puis du lit au lit.
Justine et Célestin sont deux personnes simples et dignes. On sent leur décalage avec notre présent, on devine un siècle traversé, avec tout son cortège de blessures. La narratrice ne cherche pas à rattraper leur époque, elle traduit. Et c’est peut-être ça, la plus belle définition de l’amour : traduire la langue de l’autre sans le forcer à parler la nôtre.
Pascale nous décrit cette vie de plus en plus terne, une attente de la mort aussi.
Mais pas seulement. Elle fait aussi affleurer des petits riens oh combien importants. Une plaisanterie douce, une main posée, un souvenir qui redevient clair pendant dix secondes et qui suffit. Ces frémissements de vie sauvent le texte de la plainte et le lecteur de la tristesse pure. On en sort ému, pas accablé.
Pascale Guillemin m’a confié « Je n’écrirais plus ce texte comme ça » : Je réponds : Alors c’est tant mieux que ce texte existe
L’autrice a « grandi » et n’écrit plus de la même manière, voilà sans doute pourquoi ce livre compte. Il a capturé un état d’âme : celui d’une adolescence qui ose regarder sans grands mots. Ne lit-on pas pour trouver, dans une œuvre, la capsule intacte d’un moment de vie ? Pour moi, cette adolescente a encore le droit d’être lue car elle nous manque souvent, cette voix sans cynisme qui nous apprend à refaire attention.
Ce texte m’a touché car nous avons tous croisé une Justine ou un Célestin. Nous cherchons tous une langue qui parle du vieillissement sans départir les personnes de leur dignité. il est précieux d’entendre la jeunesse décrire la vieillesse sans condescendance.
Ce journal intime est sobre et exact. Comme dans la chanson de Brel, Justine et Célestin attendent leur fin... Alors que Pascale reconnait en eux ce qui reste de vivant.
J’ai lu ces pages comme on écoute une pendule dans la nuit : pas pour savoir l’heure mais pour la simple compagnie du temps. Justine et Célestin y avancent à petits pas qui résonnent. La voix adolescente qui les accompagne ne commente pas : elle garde et veille. Et c’est peut-être ça la littérature quand elle est juste : une manière d’être encore là quand la vie s’éloigne.

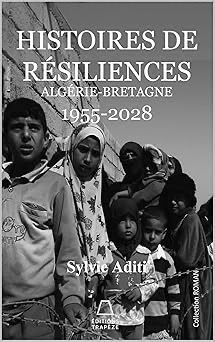


Commentaires