SeulS de Pascale Guillaumin
- Jean Benjamin Jouteur
- 30 août 2025
- 5 min de lecture

J’ai lu seulS de Pascale Guillaumin
Très courtes nouvelles, dénouements rapides. Très bien écrites et souvent pleines de mélancolie.
Il y a des livres qui ne se lisent pas : on s’y promène. seulS est de ceux-là.
Imaginez une petite ville en lisière d’une grande métropole, assez proche pour qu’on la confonde, assez différente pour qu’elle garde son accent propre : ouvrière et un peu paysanne, mains noircies par le travail et poches pleines de petites histoires.
Dans cette ville, une ruelle. Pas tout à fait droite, pavée par endroits, terre battue ailleurs. Des maisonnettes basses, chacune avec sa signature : un rideau croche à la fenêtre, un pot de géranium, une sonnette qui a connu de meilleurs jours. C’est là que le livre commence, et qu’il finit. Chaque porte qu’on pousse est une nouvelle ; chaque seuil franchi, un instant de vie offert « comme ça », sans bruit, avec cette pudeur qui n’appartient qu’aux gens qui n’ont pas l’habitude de se mettre en avant.
Pascale Guillaumin écrit court. Non par économie sèche, mais par respect. Elle n’arrache rien aux personnages : elle recueille. Les textes s’ouvrent comme des portes entrouvertes, on glisse la tête, on respire l’air de la pièce, on entend deux ou trois phrases, un rire, un soupir, le couvercle d’une casserole qui tinte, le bus qui passe, la bouilloire qui chante, et déjà il faut ressortir.
Dénouements rapides, oui, mais pas bâclés : ce sont des chutes comme des pas de côté, des virages nets pris à petite vitesse, qui laissent derrière eux une traînée de sens. On s’aperçoit alors que la brièveté n’a rien d’un caprice : elle est la forme juste d’un monde où l’on se croise sans s’étaler, où l’on se confie un bout de fil et non la pelote entière.
Pourquoi ai-je choisi cette métaphore de la ruelle ? Parce qu’à mes yeux elle montre la structure même du recueil. Maison après maison, texte après texte, un quartier se dessine ; et, de seuil en seuil, ce sont les circulations qui comptent. La ville de seulS est une géographie affective : un plan de rues où la mélancolie n’est jamais spectacle mais météo. Parfois un crachin fin, parfois un ciel bas, puis soudain une percée de soleil sur une façade, un détail tendre, une répartie drôle, la petite obstination du vivant. On referme la porte en se promettant d’y repasser, mais déjà une autre poignée nous appelle.
On pourrait croire que ces « petites choses » n’ont pas d’importance : une phrase qu’on n’a pas dite, un objet rangé trop tôt, une visite écourtée, une vieille peur qui revient avec les soldes. C’est l’un des jolis tours de seulS : rappeler que c’est justement là que se jouent les grands virages de la vie. Un rien, et tout bifurque. L’auteure a l’art de l’angle : elle arrive au moment où la trajectoire change de quelques degrés, pas de drame tonitruant, pas de carambolage narratif, mais le discret « clic » d’un clignotant intérieur. Et ce clic, une fois qu’on l’a entendu, on ne l’oublie plus.
Ce recueil porte en lui la politesse du regard. Les personnages ne cherchent pas l’emphase ; ils ne veulent pas qu’on les suive trop longtemps. Ils donnent, puis ils referment. Non par défiance, mais par délicatesse : « voilà ce que je peux partager, voilà ce que je garde ». Cette retenue fabrique la mélancolie douce qui traverse le livre. On aimerait rester davantage, poser une main sur l’épaule, demander : « Et toi, comment vas-tu… maintenant ? » On sait qu’on ne le fera pas. La page, comme la porte, se referme sans claquer.
Le style est sobre, précis, sans effet de manche. Les phrases tombent droites, les verbes font le travail, le rythme sait que la musique tient autant aux silences qu’aux notes. On sent l’oreille d’une autrice qui écoute avant d’écrire. C’est ce qui donne à ces chutes rapides leur densité : elles ne « surprennent » pas, elles révèlent. On croyait tenir une broutille, on se retrouve avec une clef dans la main. À nous de deviner quelle serrure elle ouvre.
On avance ainsi, de porte en porte, dans ce quartier des vies : l’ordinaire est l’impossible mission de la littérature. Rendre à ce mot sa noblesse, en réinventant le regard. seulS s’y emploie avec tact. Il y a de l’humour qui glisse par endroits, sec et bienvenu, comme une lumière qui ne s’attarde pas. Il y a surtout la pudeur d’une écriture qui ne juge pas, ne médicalise pas la tristesse, ne maquille pas la joie. Elle la montre telle qu’elle passe sur un visage, et s’en va.
Arrivé au bout de la ruelle, on se retourne. Où sont passés celles et ceux qu’on a croisés ? À quelle fenêtre s’adossent-ils maintenant ? Dans quel jardin minuscule font-ils sécher leur linge ? On a envie de remonter la rue à l’envers, de heurter chaque heurtoir, d’oser : « Pardon de déranger, je voulais juste savoir… » Mais non. Ils nous ont offert leur mesure. Ils n’ont pas promis la suite. Leur futur leur appartient, et c’est très bien ainsi. La littérature, ici, ne confisque pas la vie : elle la salue au passage.
seulS apprend à regarder. Il rappelle que la densité d’une existence se niche dans les presque-rien qui, à force d’être dits sans grandiloquence, deviennent essentiels. Il donne envie, une fois le livre refermé, d’habiter autrement sa propre rue : de prêter attention à la voisine qui arrose trop, au monsieur qui parle à son chien, à l’adolescente qui marche vite pour paraître sûre. Il prouve, avec une belle simplicité, qu’on peut écrire court et élargir l’horizon.
Cette ruelle prend vie chaque fois qu’on ouvre seulS. On y apprend la patience, le tact, la gratitude. On y comprend que « ne pas s’attarder » n’est pas « rester à la surface » : c’est parfois la seule façon d’être juste. On y découvre surtout que ces « petits moments », ceux que l’on croit insignifiants, sont les véritables carrefours : des virages de vie, discrets, décisifs, qui nous redessinent sans faire de bruit.
Au bout de la promenade, on reste un instant immobile, la main encore chaude de toutes ces poignées, un peu mélancolique. On range le livre comme on met la clé sur le clou à l’entrée : pour la reprendre demain, repartir au petit matin, et pousser d’autres portes.
Parce que les rencontres modestes sont souvent les plus fortes, et que la littérature, quand elle sait se taire, nous parle infiniment.

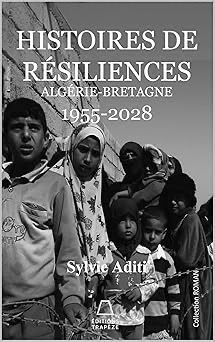


Commentaires